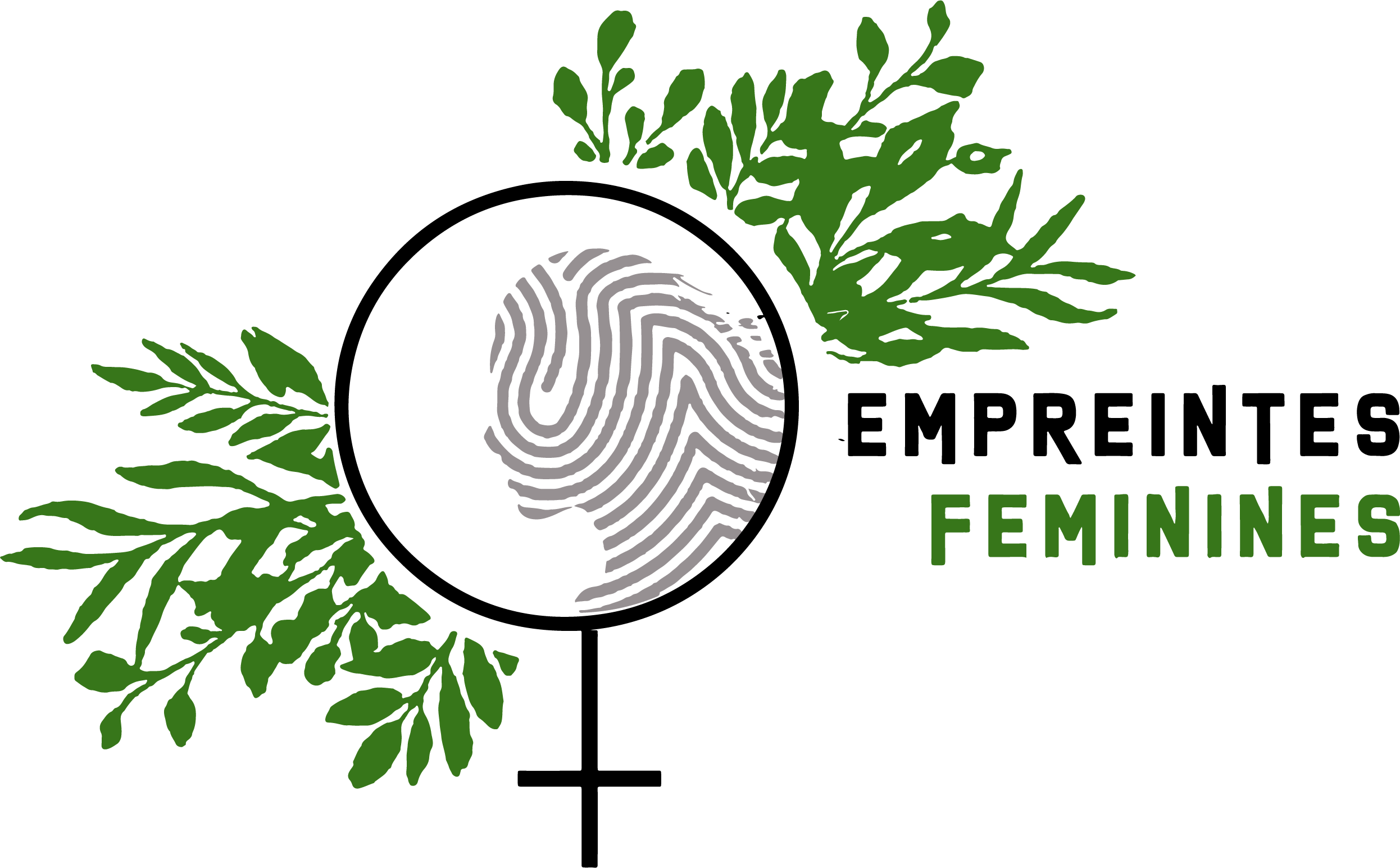MIEUX ENSEMBLE : autonomiser les femmes grâce à des réseaux sociaux plus solides.
Aux États-Unis, la femme moyenne a huit amis proches. Dans les États de l’Uttar Pradesh, de l’Orissa et de l’Uttarakhand en Inde, les femmes rurales sont beaucoup plus isolées socialement, avec seulement un à trois de ces liens sociaux en moyenne. Les données d’enquêtes à travers le pays indiquent que 60 % des femmes ne sont pas autorisées à se rendre seuls dans des lieux tels que le marché, les établissements de santé et à l’extérieur du village. Environ un quart des femmes ne sont pas autorisées à rencontrer des amies et un quart des maris insistent pour toujours savoir où se trouve leur femme.
Dans les pays en développement où les marchés et les institutions sont faibles, les réseaux sociaux sont particulièrement cruciaux. “Les réseaux sociaux sont une composante clé et sous-estimée du processus de développement économique et humain”, a déclaré S Anukriti, économiste à la Banque mondiale. “Les réseaux sociaux sont une source de crédit informel, d’assurance et d’informations sur des choses comme les emplois, les droits, ainsi que les services de santé et la technologie, tels que ceux liés à la fertilité et à la planification familiale.”
Dans le cas de l’Afrique, en Côte d’Ivoire, la femme rurale incarne cette même réalité sociale. Elle est victime de discriminations négatives, dont la source est associée à la volonté des « ancêtres-dieux » (Ehui, 2019). À cette pesanteur religieuse qui diffuse crainte et peur, s’ajoutent les actions néfastes de l’organisation sociale traditionnelle et du système colonial (Assié-Lumumba, 1996 ; Ouattara, 2007 ; Touré-Diabaté, 2010). En effet, dans le processus de socialisation, l’homme et la femme sont assignés dans des rôles sociaux différents. Cette distinction sexuée confine la femme dans une position sociale minimaliste qui la relègue au bas de l’échelle sociale.
Comme preuve, depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire, l’entrepreneuriat social féminin est apparu comme le maillon faible jusqu’à la mise en place de la loi coopérative (loi no 97-721 du 23 décembre 1997). Cette nouvelle disposition a favorisé la naissance et la floraison de coopératives et associations féminines (Dibi, 2001) ayant participé à l’amélioration du bien-être et à la stabilité financière des femmes (Gouentoueu, 2014). Aujourd’hui, les coopératives et associations féminines sont devenues une stratégie pour contourner les contraintes socioculturelles (Vanga, 2012) et un facteur de construction du leadership féminin (N’Goran, 2012).
Depuis quelques années, les femmes de Djangobo et de Dramanekro se sont inscrites dans ces formes de pratiques entrepreneuriales. Vivant dans un milieu social dans lequel l’ancrage culturel des rapports de pouvoir homme-femme est toujours vivant, la gent féminine a fait son entrée dans l’entrepreneuriat social avec des noms évocateurs.Ceux-ci expriment à la fois une reconnaissance consciente du statut de cadette sociale et un refus de demeurer dans la triple invisibilité du faire, du statut et de l’être (Voirol et Faes, 2013).
De par ces différents cas illustrés ci-dessus, il est bien démontré que la femme à travers le monde, subit des discriminations qui indéniablement constituent un véritable frein au bon développement de la société dans son entièreté.
Les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d’éducation. A ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental. Je suis même convaincue que donner aux femmes le droit de choisir leur vie en toute autonomie, partout dans le monde, est l’une des clés pour relever les défis de ce siècle.

G.Makaya